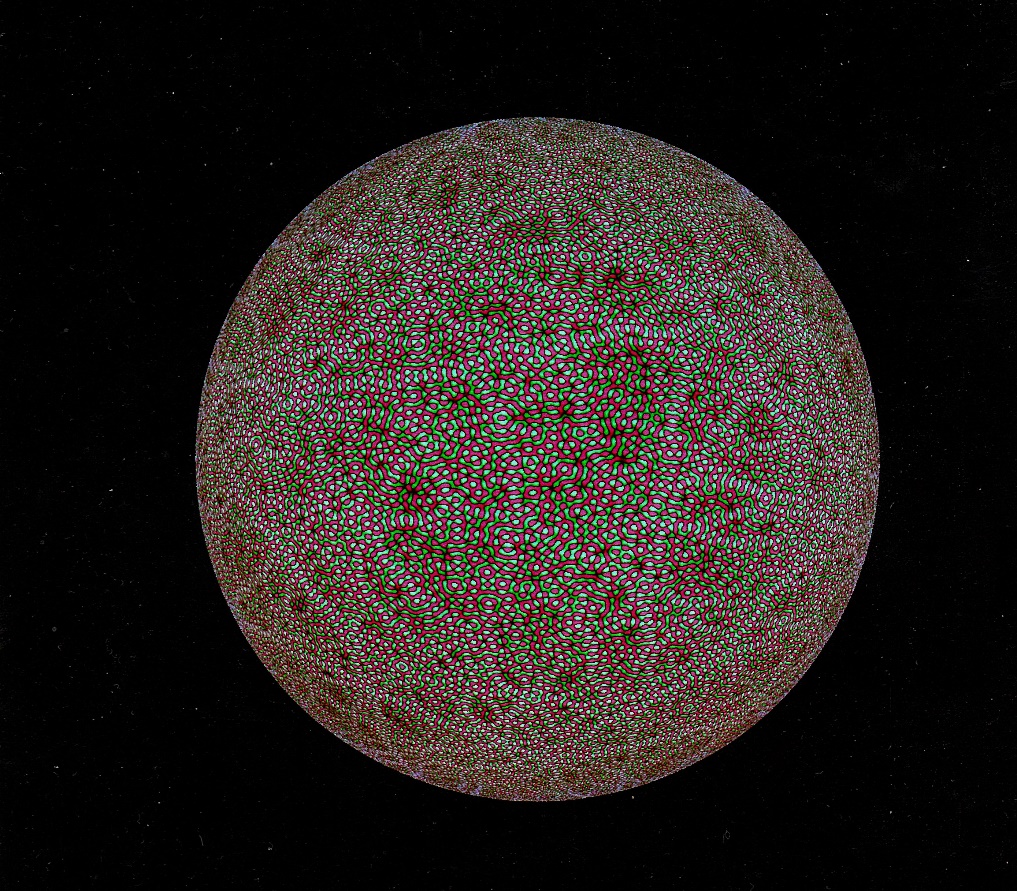« Quand la nuit tombait noire en plein midi… »
Andreas Gryphius
La langue du désastre, que la marchandise a réussi à imposer avec la fortune que nous lui connaissons, décrit l’essence du travail dans la société cybernétique avec une relative perfection. Cette langue, imposée par toutes sortes de biais et diffusée par un très grand nombre d’agents de cette société est désormais confusément perçue par ses locuteurs comme étant la censure elle-même et l’un des plus sûr indices des avancées de leur servitude. Ces agents, les sidérés – nous les nommons tels qu’eux-mêmes se sont nommés dans le but d’obtenir une garantie d’innocence dans la garenne intellectuelle où ils ont détalé, et dans leurs bouches prostituées l’emploi de ce substantif vaut brevet d’Etat – viennent d’arriver et découvrent, ou semblent découvrir, tout d’un coup et presque d’un seul, les irrésistibles performances du Capital et les progrès de sa seconde nature, comme si nous étions face à un brutal basculement du monde qui n’avait été annoncé par rien.
Ce désastre, devenu le cadre quotidien de l’existence de la monade informée avec un sceau d’infamie apposé sur tout ce qu’elle touche, sous la forme immensément aggravée que nous lui connaissons aujourd’hui, est le produit de la conjonction planifiée d’un nombre important de faits que nous avons précédemment décrits sur birnam.fr. C’est également la conclusion d’un long processus engagé depuis de longues décennies, n’en déplaise à ses contempteurs qui le pensent comme un surprenant commencement alors que nous sommes arrivés aux temps de la conclusion, et, forcément, du triste bilan.
Sans cesse amplifié par les paniques diffuses surgissant du monde sans contact, ce désastre qui semble ne pouvoir être arrêté par rien, parce qu’il contrôle ses oppositions et quelquefois les invente et les produit sur sa scène afin de se ménager de courtes pauses nécessaires, déroule ses programmes d’asservissement et peaufine leurs plus rudes aspects dans un assentiment général. Ce désastre a défini, par ses invasions successives, en échelons, depuis un demi-siècle, les limites de la seule vie disponible pour l’esclave, ou, du moins, de la seule que celui-ci croit encore possible selon les persuasives homélies de la marchandise. La société cybernétique, qui n’a longtemps vécu que dissimulée dans le creux de ses ombres idéologiques et de ses artifices matériels, s’expose désormais en pleine lumière, à la vue de tous, dans sa galerie des glaces. La construction de son sarcophage numérique désormais en voie d’achèvement est une assurance d’éternité pour la classe dirigeante de la société cybernétique. Elle a conjugué l’ensemble des soumissions obtenues, sans vraiment forcer sur ses dons de persuasion et d’éloquence, avec la logique froide de son clergé de la machine que rien ne tempère dans ses volontés de destructions et d’exterminations revendiquées ; qui, maintenant face aux résultats advenus, auxquels personne n’échappe, s’acharne à ce que rien ne dépasse du couvercle.
*
Nous sommes passés des promesses idylliques que l’on nous chantait aux sanglantes réalisations d’un monde qui ne se survit à lui-même que par ses effondrements successifs. Ceux-ci, dans une léthargie prolongée qui n’épargne aucune des classes de la société, ont été transformés en techniques gouvernementales, en stratégies de marché et du désastre, en guerres hors limites, en exterminations productrices sur l’espace vital de la marchandise. Ces promesses retournées, qui débordaient depuis longtemps du marché des falsifications et de ses poubelles récréatives, n’ont jamais été vraiment entendues, ni pour ce qu’elles étaient, ni pour ce qu’elles valaient vraiment, malgré les exemples en cascades qui s’accumulaient dans une indifférence générale. Les sidérés, dont l’espèce s’est singulièrement multipliée ces derniers temps, se refusaient à comprendre ce que ces promesses entraînaient à court terme : ce qui, dorénavant, court vers sa brutale conclusion. La sur-mobilisation des populations pendant la fausse pandémie a été l’un des moments paroxystiques de ce processus, quand la domination s’est épurée et s’est recentrée autour de ses fondamentaux économiques et sociaux, ainsi qu’elle a toujours su le faire, en venant par le côté le moins gardé, aux bastions désertés et spécialement désarmés par un personnel de service, recruté sur la base de critères de sélection inversés pour accomplir cette contre-révolution préventive jusque dans ces crimes ( et parfois jusque dans les énigmatiques assassinats qui ponctuent le déroulé du programme informatif ).
Pendant ce vaste éclaircissement de bien-fonds, cette accumulation de dépossessions, on a constaté l’éclatement des minces cloisons qui séparaient, prétendait-on, l’existence en sphères que l’on croyait, il y a peu de temps encore, autonomes (public/privé, étant l’un des exemples les plus connus). Elles se sont écroulées sur elles-mêmes, compressées sur un seul plan, sous le contrôle des maîtres du temps ; et conséquemment comme son meilleur résultat, au milieu de ce qui est ressenti comme une nouveauté perpétuelle – la mémoire ayant été abolie en chemin –, la perte de toute langue commune au profit d’une caricature de langue, un basilecte neutralisé, désinfecté, universel, dont chaque langue naturelle, subvertie avec méthode, est devenue l’hôte accueillant, reconfiguré, réductible à un outil.
*
Le vocabulaire abondant et changeant de la langue de la servitude marque le véritable territoire où s’accomplit l’existence du citoyen informé. Il indique également ses limites, vite atteintes dans tous les domaines que celui-ci aborde : ses loisirs, sa vie intime, ses rencontres, sa sexualité, ses passions, son travail élargi à la dimension de l’existence…
Parce qu’il lui faut entretenir sa tenure autorisée, il doit se gérer aussi froidement qu’il est géré et, régulièrement, dégraissé par ses maîtres au bout de sa course utile ; c’est ce qu’il tend à admettre sans combat, car il n’imagine pas d’autre emploi de sa vie ; et parce qu’il ne trouve rien de ferme à opposer à la barbarie de son existence. Il lui faut, aussi, se remettre en question en permanence, c’est-à-dire se mettre de lui-même sur le chevalet car ses maîtres l’ont amené, insensiblement, par les exercices spirituels qu’entraîne l’aliénation marchande, à la certitude qu’il a dû commettre une faute, quelque part, pour laquelle il n’a pas encore récité sa contrition. C’est devenu une discipline de tous les instants, obsédante, ubiquitaire : le citoyen informé ne doit jamais perdre la main dans ses ajustements avec la méga-machine. Ses maîtres lui assurent qu’il ne correspond jamais suffisamment avec le rythme de celle-ci. Il doit se mettre en scène et ne point laisser transparaître les ficelles et les rouages de sa machine catatonique secouée par les faims inassouvies de la machinerie cybernétique. On ne lui donne pas d’autres choix que de les prendre et de les défendre comme étant les siennes. On le lui répète en permanence. Il est à lui-même un spectacle vivant dont jamais ne cesse la séance. Il ne s’en décale que pour sombrer dans la dépression, l’angoisse, la folie ; ou dans de curieuses effervescences contrôlées que leurs victimes, dans leur impatience de perdre leurs chaînes réelles ou fantasmées, analysent comme les effets de l’effondrement du monde de la marchandise et que les logiciens leur présentent pour telles – le festif sous toutes ses formes tolérées. Ces cérémonies sont, le plus souvent, rationnellement enclenchées aux moments opportuns, ou détournées comme l’on détourne un cours d’eau, par un personnel spécialisé dans l’anéantissement passionnel de l’élémentariat, pour relancer la machine par des séries de courtes régulations jouant sur l’exploitation passionnelle de publics fabriqués et spécifiques. C’est un négatif en dégénérescence qui distrait son public par son faux tragique grimpé sur tréteaux médiatiques en guise de cothurnes, alignant ses protestations fragmentaires et calibrées, prolongées de mois en mois par de fausses attaques sur des cibles de décharge – « la valeur c’est le mâle », quoique taillé sur un patron connu, en reste le nouveau modèle insurpassable, fonctionnel, fabriqué par des marxistes en granulés.
*
Le micro-atelier homme se doit également de travailler à s’investir dans son réseau relationnel : ce sont des expressions qui démontrent, à la fois, l’intimité que le citoyen informé se flatte de connaître dans ses fusions avec la machine, la parcimonie des amours et des amitiés modernisés débarrassés du voile d’une encombrante morale, leur exact degré d’asepsie qui, dorénavant, les rend aisément remplaçables par les cartes de crédit du convivial numérique et ses communautés invisibles. Evanescentes communautés engendrées par la logique de la marchandise, dans le bain d’impulsions proportionnelles qui les sollicite dans son flipper cybernétique. Il ne faut pas oublier, non plus, le célèbre fonctionner qui émaille les pseudo-conversations des mécaniciens de la logique relationnelle en attente d’un dépannage rapide sur le chantier d’une vie démontée. Il exhibe son locuteur comme une cristallisation marchande synchrone dans le déroulement d’une déshumanisation générale. La monade travaille sur elle-même à devenir ce souple animal sadien délié de ses illusions sur sa propre nature : une monade réalisée déliée des encombrantes pesanteurs de ses anciennes déterminations, traditions, attachements. Une monade dévitalisée dont le travail consiste à fuir le monde sans qualité de la marchandise pour se replier dans une intériorité informe et préfabriquée, qu’elle fuit à nouveau pour, dans un mouvement perpétuel, s’éparpiller dans la pure extériorité de ce cercle vicieux. Dans la perspective de l’utopie-capital, l’élément doit s’éprouver comme une souillure, un insatisfaisant porteur de marchandises.
*
Ce langage réifié et son vocabulaire de l’épouvante, qui est un produit de la désintégration sociale, au même titre que le fast-food et le hamburger, démontre comment la marchandise a reconstruit le vivant pour en faire sa caisse de résonance. Et comment ceux qui l’emploient volontairement, par ignorance calculée ou réelle, par hypocrisie, par métier ou par mimésis, se flattent d’être les familiers du Moloch cybernétique dans lequel ils s’engouffrent volontiers pour les agapes sans fin de celui-ci. Ces quelques termes ou expressions dont nous citons les plus connus sont des invariants de la langue de la servitude, d’autres ont pour rôle d’indiquer avec exactitude, la zone industrielle fréquentée par le personnel de la machine (publicité, pédagogie, journalisme, politique, art, littérature, gouvernement, police, industrie, bureaucratie, maffia…) tels zapper, se défoncer, se prendre la tête, prérequis, sous-staffé (?), over-bouqué, check-point, dead-name, destitué, border-line, sidéré… Ils sont les marques d’infamie qui ponctuent des discours signalant une servitude que ses possesseurs forcent ainsi qu’une plante hydroponique dans un tunnel de maraîchage. Ils sont aussi des signes de connivence. La certitude d’être compris par les habitués de l’organigramme renforce la conviction irrationnelle de faire partie d’une communauté qui ne se manifeste que par des groupes de vocables habilement dispersés dans la langue du désastre du moment. Ils sont des signaux dans le brouillard empoisonné de la société cybernétique. Ils créent la sensation d’un rapport social entre initiés : battant cherche cloche pour s’éclater, effets pervers s’abstenir.
*
Plus inquiétante est la tendance à la détérioration continue de la syntaxe qui suit, et l’alimente en la taclant, celle de la conscience. Phrases sans verbes et verbes sans sujet donnent l’impression d’un autisme généralisé : il semble que le locuteur heurte le clavier d’une machine simplifiée avec une massue de métal ; heurt dont il ne faut retenir que l’écho qui se répète. C’est aussi un cri de détresse de la créature opprimée. Il n’est pas rare que l’esclave moderne prononce sur un ton autoritaire, après qu’il a exposé ses idées ou cru le faire : en tous cas dans mon esprit à moi, c’est clair, ou quand il se heurte de front à sa dépossession : je me comprends, mais je n’arrive pas à le dire. C’est à la fois un constat de défaite et d’impuissance face à une intériorité normalisée par les industries de la psyché qui dévorent sa subjectivité et un grandiose résumé des privations subies au service du grand algorithme. L’élément se perd en perdant ses mots et en perdant ses mots pour se dire et dire, il sombre dans l’atonie. Une ponctuation de l’épouvante surgit dans la plupart des discours de la monade apeurée : absolument porte vers des sommets himalayens son acquiescement à n’importe quoi ; cinq sur cinq prouve qu’elle s’est réglée sur la seule et unique fréquence : la bonne ; elle s’y module, s’entend à le rester quand elle croit y entendre son âme, ou quelque chose qui n’y ressemble en aucune façon, mais le prétend. Ces manières de parler prouvent l’enrégimentement de la monade dans l’usine-monde.
*
Une parole militarisée et aplatie, policière et singulièrement nettoyée, s’est installée, telle un bourdonnement permanent surplombant la vie entière. La langue de l’équarrissage unifie et régule tout sur la base des quelques principes rudimentaires qui ont déjà aménagé le reste de la vie : le domicile – standardisé et annexé par l’organisation scientifique du travail et ses machines de dressage ; l’intime – réduit à une peau de chagrin grâce aux multiples normalisations feutrées qui s’y déploient, tel un cauchemar, pour en finir avec les ultimes libertés résiduelles qui pouvaient y subsister ; les incroyables loisirs – proposés dans les assommoirs à répétition du panoptique et vécus comme d’authentiques libérations par la monade informée.
Cette langue du contrôle et de la surveillance millimétrique témoigne, à sa manière, sur l’étendue des zones d’opérations de la monade en service, ainsi que sur la qualité d’un territoire progressivement enfermé dans les nouvelles divisions administratives créées pour faciliter l’usage des instruments de la société cybernétique.
La langue de la servitude est une réverbération des désirs du maître dans l’âme de ses locuteurs asservis. Persuadés de la parler machinalement, car ils n’en ont pas trouvé d’autre, ni même cherché, puisqu’ils ont été amenés de degré en degré à en perdre les moyens et jusqu’à la curiosité d’en chercher une, elle est l’aveu de l’estime que l’esclave de la société cybernétique porte à l’esclave. L’imbécile et effroyable H.S est l’exact résumé de cette réduction à la jivaro sur l’espace social des objets. L’élément se place ipso facto du côté de la puissance qui le broie, et ricane avec elle quand un concurrent trébuche. Donner à voir montre l’épaisseur et la qualité des potlachs de la domination, et le travail qu’elle exige de ses esclaves : toucher des yeux. Rien ne supportant un véritable examen, ni la nourriture, ni les rapports sociaux, car c’est toujours moins que rien qui est offert à la contemplation.
*
Nous sommes dans le jardin des délices kafkaïens où nous ne savons plus ce qu’il faut vraiment admirer : les désirs de la marchandise ou ceux de l’élémentariat affranchi s’exprimant dans la belle langue du despotisme. Plus qu’une rhétorique, la langue du désastre est une procédure légale appuyée sur des tribunaux d’exception d’une moralité impitoyable, exemplaire. Ses juges ne connaissent que des condamnations définitives pour les crimes que signalent les néo-sycophantes de la tyrannie, quand ils ne les inventent pas. Ils parlent au nom de la puissance qu’ils servent, et selon l’ordre de priorité qu’elle se fixe. La langue de l’équarrissage a le droit pour elle, tous les droits. Elle le rappelle à la moindre occasion, dans un monde où les oligarques multiplient les lois pour les suspendre.
*
Les pseudo-discussions qui n’en finissent jamais, chicanières et labyrinthiques prisons sophistiques étendues aux dimensions d’une existence, dissimulent, le plus souvent et de manière intéressée, la misère mécanisée, et assez généralement consentie, sous les allures d’une gaieté surjouée, engluée dans une sorte de rassemblement politique permanent. Ces pseudo-discussions construisent, avant tout, une unanimité de façade. Cela constitue un crime de la fracasser. L’envie n’en manque jamais, mais elle ne sait plus comment se satisfaire. Elle en a perdu le désir et, plus que tout, les moyens ; et sombrant désormais sous une avalanche d’interdictions, les plus vaillants ont été conviés, de ce fait, à une prudente retraite, sinon à un silence désabusé. Les participants de la langue du désastre, toujours décontractés, s’observent haineusement pendant leurs performances anti-complotistes.
La langue du désastre est aussi un glacis où les locuteurs multiplient les chausse-trapes de la mauvaise foi la plus épaisse, empruntées aux techniques des communicants bolchevisés qu’ils écoutent. Ils les croient admirables parce qu’ils les voient partout invaincus et sans négation. Ils savent qu’il faut respecter la force, ou ce qui lui ressemble ou l’imite avec beaucoup de bruit et se montre dans son cercle de flammes : ce ne sont qu’interdictions, objurgations, injonctions, ordres et déclarations comminatoires – des claquements de fouets.
La contradiction, cette vie de la parole, est considérée comme la peste qui, elle, est plutôt subie sans récriminations, pacifiquement, puisqu’elle est devenue, sans aucune retenue, l’un des arcanes gouvernementaux du juke-box cybernétique. L’essentiel s’exprime d’une manière plus sournoise, et toujours ailleurs. Calomnies, rumeurs, jalousies, rancunes et dénonciations règnent sans conteste dans les réseaux relationnels ; leur but est l’assemblage de gens désarmés, soupçonneux, qui se rencontrent sur la base d’une hostilité mutuelle larvée ; elle ne se dit jamais ; elle est d’une science inouïe pour se faire ressentir d’une manière occulte. C’est intuitivement que le citoyen informé met en pratique les anciens axiomes de la méchanceté sacerdotale. Il n’est pas seulement l’officiant de son propre anéantissement spirituel, mais il est aussi chargé de vérifier celui de ses compagnons en servitude. Il épie son voisin de chaîne dans l’usine-monde et blâme son peu d’ardeur quand celui-ci part aux récoltes obligatoires des ersatz qui poussent comme des champignons vénéneux autour de lui. Si l’ambition de la marchandise et de l’Etat était de transformer chacun en contremaître de la soumission de tous, la société cybernétique est le résultat incontestable et poisseux de cette ambition puisque l’esclave descendant dans ses surveillances, de degré en degré, parvenu au ras de lui-même en est venu à se surveiller lui-même ; jusqu’à se surprendre parfois comme complotiste.
*
Les citoyens informés ne connaissent rien d’autre depuis leur naissance que le crépitement de la langue du désastre et, pour le plus grand nombre, ne cherchent pas à éviter ses tirs dont ils sont accablés jusque dans leurs rêves. Leurs pauvres parents ne savaient déjà plus rien et l’école réformée de la société cybernétique ne sert à rien à leurs enfants. Ceux-ci, dans leur grande majorité, n’arrivent pas même à reconnaître les escrocs simplifiés qui se sont singulièrement et rapidement multipliés sous les projecteurs de l’ignorance. Leurs professeurs formés aux méthodes ingénieuses de l’ignorance, qui leur sont apparues sous des noms prétentieux et grandioses pendant leurs études sommaires, n’ont rien trouvé à y redire : elles fonctionnent apparemment et ont un débit mesurable. On le leur a médiatiquement expliqué et ils n’ont jamais cherché à en savoir davantage quoiqu’ils soient au premier rang. Mais ils sont dans l’obligation de dissimuler les ignominies de la société cybernétique. Ils la défendent en accompagnant docilement les programmes de fabrication de l’hilote massacré cognitivement. Ils ne méritent pour la plupart que du mépris et sont incapables d’enseigner quoi que ce soit quand on y regarde de plus près : ils sont eux-mêmes les victimes et les complices de ce qu’ils font mine de ne pas reconnaître. Que peuvent-ils apprendre aux autres de ce qu’ils n’ont pas appris eux-mêmes ? Les énoncés les plus fragiles sont admis et deviennent des vérités qu’il est non seulement dangereux de contredire mais le plus souvent impossible.
Le citoyen informé n’a jamais été instruit, il n’y a plus personne qui veuille s’en donner la peine et tenter de le faire est considéré comme un scandale, une provocation à la révolte. Le citoyen informé n’est plus éduqué et ce serait une perte de temps que de le faire : il n’y a plus rien à respecter sur cette planète. Le citoyen informé est fabriqué sur des modèles simplifiés, à l’emporte-pièce, dressé sans pitié sur la fraiseuse spectaculaire, après avoir été tourné dans l’ensemble de ses besoins, de ses désirs et velléités, qui après avoir été raboté ont moins de valeur qu’un copeau ou qu’un sac de sciure.
C’est jusque dans leurs disputes infimes que les monades informées tiennent à manifester leur solidarité organique avec le grand métaphysicien. Ils sont d’une infinie inventivité pour la marquer. Ils croient qu’ils parlent le langage de la liberté, quand celui-ci a été réduit à une signalétique de panneaux routiers.
Fin de la première partie
Notes éparses sur la nuit cybernétique
Jean-Paul Floure