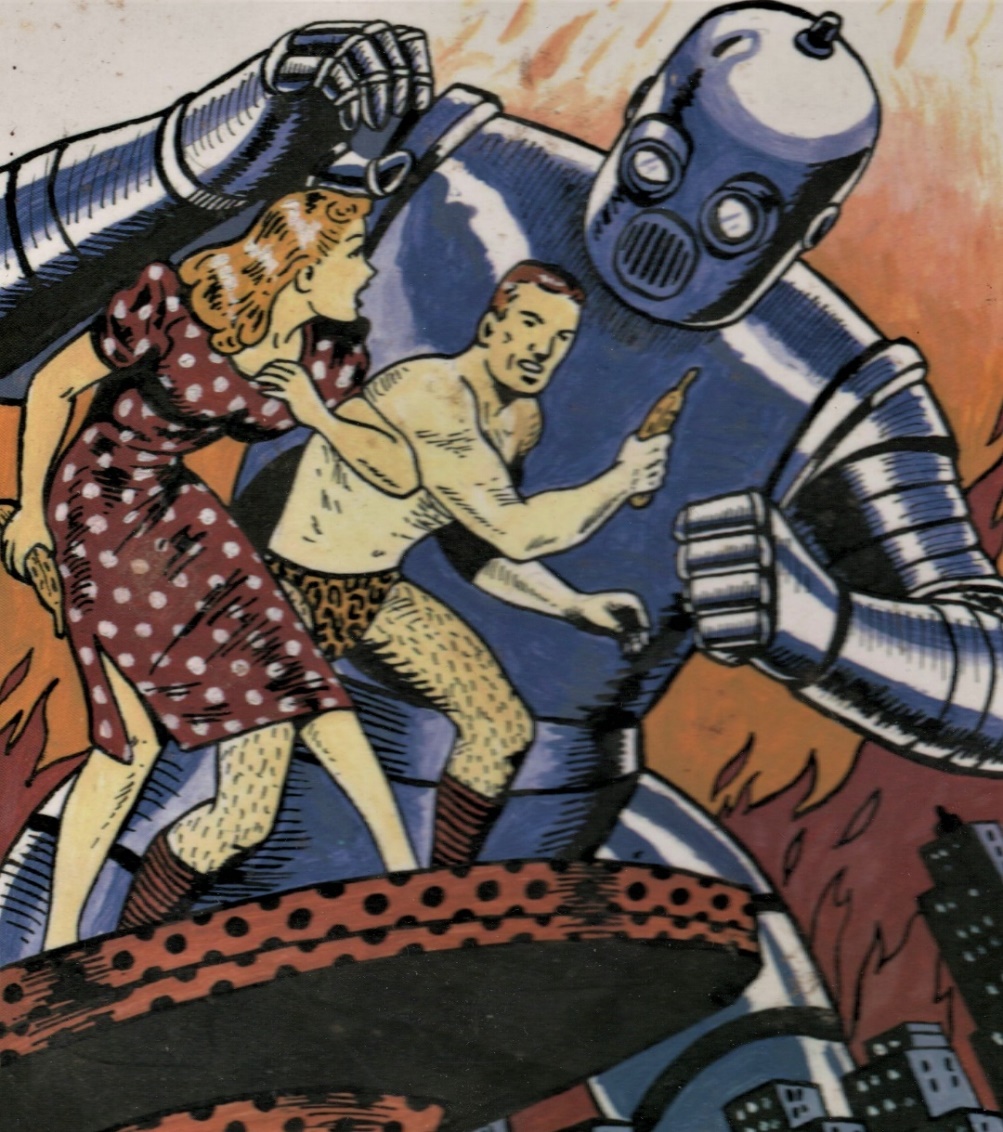
La propagande a connu un remarquable développement depuis que l’art est mort. Son triste délabrement avant-gardiste n’a gardé de l’art, à la suite d’une rigoureuse sélection de ses capacités à mobiliser et à manipuler émotionnellement les éléments, séparément ou en foule, que les matériaux utilisables au service de la propagande devenue le seul et unique art de notre temps, son foyer central. Le résidu de cette analyse nécessaire a été abandonné sans remord ou détruit irrémédiablement car ne pouvant pas être décemment réemployé au service de la méga-machine cybernétique (a). Il n’en reste comme glorieux résultat, après que tout a été transformé en pissotières de tous genres, qu’un goût de latrines et des découvertes plaisantes ; la couleur réduite à une longueur d’onde a permis de rendre attrayant le papier toilette ; les mots en liberté ont permis de fabriquer des algèbres précis et sévères en faveur d’une servitude recomposée. Après avoir camouflé, assez maladroitement, les champs de canons en campanules empoisonnées, au milieu desquelles les soldats Duval ont pu dormir d’un sommeil sanglant, les peintres modernes, ou du moins ceux qui ne se sont jamais réveillés du cauchemar progressiste, sont passés avec armes et bagages au service de la méga-machine en redessinant ses impacts, en la dissimulant à l’avantage de ceux qui peignent avec du sang – un ersatz de qualitatif mis au service du véritable quantitatif et de ses assauts impétueux.
La poésie, après sa cure d’amaigrissement technique, a dégénéré en flatulences publicitaires, n’utilisant que les formes rudimentaires-dévalorisantes de sa destruction mises au point expérimentalement, en premier lieu et avec une efficacité redoutable, sur les quelques dizaines de personnes portées, par leur rationalisme amélioré, étroit et dynamique – une ruse de la raison marchande –, à l’avant-garde du désastre. Vite transformé en une nécessité économique et sociale cet appauvrissement réglé de toutes les expressions possibles, célébré comme une apothéose de la liberté, parlant avec une courte avance la langue perfectionnée et automatique de la méga-machine, a finalement réglé la vie de tous en perfectionnant l’aliénation, en rénovant sa forme et en camouflant son contenu d’inhumanité sous les litanies revendicatives et innovantes du partiel et une pseudo-profondeur vite reconvertie en un pathos standard et mécanisable à la portée des limaces de l’ordre cybernétique (cf. dada et l’ensemble de ses déclinaisons profitables aussi invertébrées qu’ennuyantes et prévisibles).
Réduite à quelques tics efficaces, depuis qu’elle s’est extravasée de ses contraintes antiques qui en limitaient, paraît-il, le champ d’expansion à quelques objets d’école dont la fonction cathartique s’était épuisée dans la glorification honteuse d’un ordre social misérable, la destruction de l’art a eu pour fonction de redonner, une fois épuisées les premières surprises de son joyeux écroulement, un lustre chthonien à la déferlante de la pacotille et une épaisseur mythologique aux administrateurs de son néant accompli – la psycho-police chargée d’assurer la cohésion de la société cybernétique par la mise à mort politique et sociale des esclaves dont elle nous vante l’esthétique radicale de leur absolue crétinisation ; en les égarant dans de fausses alternatives soigneusement et policièrement élaborées (cf. le ministère de l’Intérieur et ses dépendances artistiques suréquipées à l’instar de Beaubourg et autres châteaux de l’intégration où vient mourir ce qui a perdu toute charge critique authentique, sous les yeux bovins d’une masse d’attardés amnésiques qui ont payé leurs tickets d’entrée pour voir des collections de marchandises à moustaches répétitives et décontextualisées, n’évoquant rien de précis en dehors d’elles-mêmes, transformées par leur consommation compulsive en une thérapeutique réputée efficace – à la manière d’un stage poterie en milieu champêtre ou d’un saut à l’élastique dans les gorges du Verdon – pour soigner les rhumatismes mentaux des subalternes du Capital comme une sorte de yoga pour exciter ses eunuques par des séries de transgressions utiles à son déploiement total ).
Le grand bénéfice de cette décomposition accélérée – car c’est une performance que de parvenir à moins que rien en 80 années – a été de mettre l’art à la portée de tous, de redéfinir son périmètre qui s’est étendu à l’ensemble de la production des marchandises en fusionnant avec celle-ci ; à n’être qu’un département spécial dans la fabrication de l’aliénation et ne se caractérisant que par ses capacités à trafiquer, à l’aide de ses ponctionnaires professionnels, d’immondes nouvelletés sur ses anciennes et premières démolitions contrôlées et subventionnées par des gens de goût.
On l’avait bien compris : c’est en étant fait par tous ceux-là que l’art ne pouvait plus être fait, sinon encore mieux défait, au profit de quelques-uns, spéculateurs avisés dans l’effondrement universel.
C’est en partant d’une critique auto-limitée d’un art tombé dans le dérisoire d’une apologie empruntant une forme négative pour se faire accepter, compromis dans de louches affaires avec le Capital, que ses héritiers en sont venus, par paliers successifs, à une collaboration ouverte avec les institutions de l’esclavage, afin de repeindre le panoptique aux couleurs de la liberté, de le décliner en de multiples versions améliorées et en lui gagnant de nouveaux territoires et de nouvelles clientèles (cf. la plateforme d’extraction passionnelle New Babylone comme conclusion imaginative de l’urbanisme punitaire de la société cybernétique – un supplément d’âme pour un supplément d’esclavage passionnel. Elle s’est conjuguée avec l’apparition de la nouvelle police et ses gestions de la paix sociale par des séries calculées de désordres transgressifs opérés par ses nomades artificiels pour gouverner les véritables monades).
Mais c’est dans la musique que cette évolution de tous les arts en leurs exacts contraires a trouvé son aboutissement presque parfait. La musique n’existe plus que sous la forme d’un bruit industriel composé de chocs rythmiques, machiniques et lourdement répétitifs.
On la retrouve partout sur le territoire de l’aliénation. Elle ne tolère aucune exception à sa présence ; elle imprègne et dégrade chaque moment d’une vie devenue résiduelle.
Elle est utilisée, d’une manière indifférente, pour vendre des marchandises et pour les consommer, comme arme de guerre et comme instrument de torture, comme adjuvant à la prise de drogue et comme support à l’accomplissement du travail.
Elle est l’ameublement obligatoire de la soumission ordinaire et un exact résumé de l’ensemble des techniques de manipulation de cette soumission qui a atteint un haut degré de technique et de scientificité entre les mains de la caste logicienne, qui n’a été retenue par aucune considération morale dans leur emploi et dans leur combinaison.
Cette musique, ou plutôt ce qui en a usurpé le nom, est le fond sonore généralisé de toute manifestation de l’élémentariat et le complément indispensable de l’ensemble des annulations de l’existence.
Les fêtes particulières de l’élémentariat, ses manifestations publiques, ses défilés de protestations, ses temples de la consommation, ses rues ou ce qui subsiste sous ce nom, ses domiciles et ses révoltes en sont inondés. C’est jusqu’aux cercueils qui sont emmenés à son rythme, vers leur destination finale.
Elle sert aussi bien à rassembler et manipuler les foules de la survie suréquipée, qu’à les disperser ensuite en se transformant en une puissante arme anti-émeute. On manifeste par dizaines de milliers contre ceci ou cela, et l’on finit par s’agglutiner, par capitulation, au concert des mécaniciens de l’absence, en grapouillant sa ligne de merguez falsifiées.
Les promoteurs du désastre s’en servent en tant qu’anesthésiant émotionnel et en tant qu’excitant passionnel, et passent de l’un à l’autre indifféremment et avec aisance. Il n’y a que le but recherché, toujours atteint avec la participation de ses victimes, méthodiquement désorientées, qui les intéresse : la désintégration des facultés cognitives permet à la misère de s’affirmer en tant que misère revendiquée et assumée par ses victimes.
Si cette parodie de musique assume ouvertement et pratiquement une fonction répressive qu’elle revendique en participant au Parti Médiatique, elle ne veut être considérée, par ses auditeurs, que dans sa fonction oppositionnelle dont les ingénieurs fabriquent au kilomètre le logiciel sonore.
En s’appuyant sur la mutilation des capacités d’écoute, déjà obtenue dans les stades précédents de l’aliénation marchande, les ordres donnés se sont émancipés de leurs formes verbales ; ordres qui restaient encore décelables et compréhensibles sous leurs formulations langagières primitives : désormais, ils ne sont plus que des stimuli – incritiquables parce que non-perçus pour ce qu’ils sont réellement : des ordres. Sur le clavier de l’aliénation scientifiquement organisée : « On a pu réaliser musicalement le procédé de Pavlov parce que nos contemporains vivent comme des chiens .» En Evoquant Wagner, Francis Pagnon (b).
Ses victimes en sont les premiers défenseurs acharnés, toujours en état de manque de ce puissant aphrodisiaque et de ses chocs recherchés. C’est ce qui marque son écrasante réussite, au-delà de tout argument, à emporter la conviction de tous ceux qui la subissent quotidiennement de leur enfance à leur mort ; si elle est assimilable dans de nombreux cas, par son côté dissolvant, à un viol psychique, elle se manifeste avant tout comme une agression totale en saturant les espaces où cette musique se déploie policièrement.
On doit tenir cette musique industrielle pour un composant essentiel de la recomposition urbaine. Les décors de la servitude la supposent comme l’une de leurs données primordiales. Intégrée dès le moment de leur conception, elle est un complément actif du béton, adaptable à tous les projets urbains, à toutes les foules qui les parcourent, à leurs évolutions prévisibles et attendues, à leurs différentes idéologies. Elle est elle-même une idéologie : c’est celle qui est partagée par tous et qui irrigue leurs comportements comme leurs pensées. Toute idéologie particulière s’y rattache avec satisfaction et s’affirme par là même comme un moment de la société cybernétique.
Elle est un outil de contrôle des comportements, une technique de massification de l’élément. Elle est un instrument du gouvernement de l’élémentariat, le plus démagogique qui soit, apprécié et recherché pour cela. Ses chefs d’orchestre s’intéressent moins à telle ou telle des formes qu’elle peut revêtir et qui s’épuisent rapidement dans leurs effets, ressemblant ainsi aux narcotiques, mais aux passions qu’elles sont en mesure de soulever afin de les anéantir en permanence en augmentant la dose – la croissance des décibels jouant ce rôle. Son emploi totalitaire sert aussi bien à promouvoir la camelote industrielle que les protestations contre celle-ci. Elle les unifie en imposant ses paysages mentaux volontairement appauvris, composés de fragments psychiques reconditionnés et stérilisés, réduits et transposés à l’état d’un court dictionnaire de signaux formels constituant une grammaire allégée, simplifiée à l’usage des conducteurs nihiliste du désastre et de leurs manipulations sensorielles.
Si souvent recherchée dans les tentatives de construction d’un art total, la symbiose entre contrainte et catharsis atteint son point culminant dans la musique industrielle et l’ensemble de ses variantes successives qui ont recherché depuis leurs débuts, chacune avec les moyens mis à disposition de ses entreprises de contrôle de la psyché humaine, cette fusion de la contrainte et de la catharsis au profit de contraintes rénovées ; où celles-ci disparaissent sous les apparats d’une catharsis simulée – jouir de son anéantissement ; il est désormais fréquent de voir un élément de la méga-machine accomplir la plus abrutissante des tâches avec un petit bouchon sonore dans l’oreille : le bonheur dans l’esclavage étant la définition de la société cybernétique. On est contre l’Etat, contre les multinationales et tutti quanti mais ce sont eux qui battent la mesure et donnent le rythme à leurs oppositions simulées. Il est presque impossible de s’y dérober, malséant de le contester, et dangereux de s’y opposer matériellement. Enoncer cette contradiction connue de tous, c’est rompre l’un des sortilèges de la méga-machine et dénoncer le répugnant et misérable prosaïsme d’une aliénation considérée en tant que magie efficace par ses laudateurs en transe.
Ce bruit volontairement infantilisant est le complément obligé du camouflage progressiste de la reconstruction du territoire ; la persistance sonore de l’usine a accompagné sa disparition comme composant central de l’existence prolétarienne. Ses chocs ont accompagné ce mouvement en se perfectionnant techniquement. En se saisissant de son appareillage technique devenu l’essentiel, ce bruit s’est transformé en instrument de la domination. Le règne du décibel n’est rien d’autre que le conditionnement à l’invivable et, plus que tout, c’est l’invivable lui-même se déployant sur la vie entière pour n’en rien laisser. C’est son ordre du jour qui est émis par les haut-parleurs jusque dans les révoltes transformées en Dyonisies de la société cybernétique : raves et botellones marquant des seuils de décompression planifiée dans la gestion émotionnelle de l’élémentariat. La réification a aussi ses célébrations, ses fêtes, ses vacances et ses émeutes garanties et protégées.
Ce n’est pas seulement l’écho de ce qui a été pratiquement supprimé, c’est la suppression même qui se fait entendre. Et là où la machine n’est pas encore arrivée, son bruit et ses rythmes l’ont devancée, et sculptent l’environnement en le pliant à ses impératifs. Ils ne peuvent pas être critiqués sans entraîner aussitôt de violentes indignations, à la fois, de ceux qui subissent son matraquage, de ceux qui en profitent et de ceux qui fabriquent à la chaîne ce bruit.
C’est jusqu’aux danses engendrées par ce concentré de matraques qui est atteint par ce processus. Elles ne sont que les caricatures, misérablement érotisées, des gestes spécialisés de l’automate humain sur la chaîne industrielle. Elles prolongent le travail de la police qui les respecte dans la mesure où elles proclament en permanence la grandeur du spectacle et le désarmement général des éléments, leur capacité à rester sous le contrôle de la machine, leur incapacité à devenir un peuple. On danse sous les caméras de surveillance à des fins d’enregistrement de son opposition fantasmée, hallucinée.
L’usine a disparu sous sa forme première, mais sa présence spectrale lui a permis de devenir totale en s’ étendant à l’ensemble d’un territoire modelé en zone opérationnelle de la passivité machinique et, sous cela, l’on retrouve d’autres manifestations : celles des débuts barbares de la société cybernétique. Les premiers spectacles totalitaires, abhorrés unanimement parce que trop évidents dans leurs objectifs maintes fois décrits, sont plutôt vantés dans leurs métastases actuelles par tous ceux qui ont fait métier de penser correctement et de faire fonctionner machinalement. Ce n’est point par hasard que leurs maîtres leur ont laissé des pianos désaccordés dans les halls de gare pour flatter leur intériorité vaincue par la mise en musique de leur mise au pas au service de la méga-machine ; et par eux-mêmes comme une autogestion sans peine de leur aliénation.
Ces chocs rythmiques sont des ordres intégrés dans la construction d’un réel en constante désintégration. Ils ponctuent l’effondrement général. A une époque où les températures météo sont relevées au sol, parce qu’on destine leur communication à l’édification morale de ceux qui rampent, c’est jusqu’à ce que l’on pouvait considérer autrefois comme musique qui est désormais entraîné dans cette transformation ; on attend avec Vivaldi, on est mondialiste avec Beethoven et discrépant avec Edgar Varèse…
Jean-Paul Floure
NOTES
a) On peut observer cette période des avant-gardes en tant que phase terminale de la disparition planifiée de l’art avec l’aide des artistes eux-mêmes. Ils n’ont vu aucune raison de ne pas se joindre au mouvement général de dissolution de l’esprit, de sa mercantilisation, et d’en tirer, à leur tour, un profit qui leur semble légitime. Devenus, pour la plupart, simples supplétifs de la société cybernétique, et pour les plus instruits des agents de sûreté, ce mouvement de dégénérescence émerveillée ( cf. les succédanés du surréalisme) leur semble comme un succès mérité et une énigme sur laquelle ils bavardent à l’infini pour prolonger l’illusion de leur indépendance ; il n’y a, désormais, plus d’autre avant-garde que celle d’une police qui a rattrapé l’ensemble de ses retards sur le mouvement réel de l’Histoire.
b) « La musique de masse est basée sur le mépris à l’égard de l’auditeur et la représentation de son existence malheureuse comme seul mode de vie désirable. Elle le réduit à une machinerie réagissant fidèlement à des stimuli grossiers, objet docile d’un système de manipulation des affects. On a pu réaliser musicalement le procédé de Pavlov parce que nos contemporains vivent comme des chiens. Hypnotique particulièrement puissant, ce bruit musical fait saliver d’envie devant ce qui ne mérite que la destruction. » Francis Pagnon, En évoquant Wagner. Editions Champ Libre, 1981.
ANNEXE
Ecrit en 1999 sous la forme d’une lettre envoyée à un détritus gauchiste, qui débutait sa carrière de sycophante culturel désormais terminée dans une insignifiance satisfaite – l’apologie de Sandrine Rousseau comme nec plus ultra de cette insignifiance – ce texte dont nous republions un extrait donne, pour ceux qui l’ignorent encore ou veulent le faire croire, quelques éléments d’analyse sur l’une des dernières déclinaisons des harmonies de la machine.
[…] Le rap est une marchandise destinée à l’écrasement sensoriel des hommes. Il est élaboré par des policiers, à seule fin de prolonger la passivité des esclaves parqués dans les zones pénitentiaires du panoptique. Les dirigeants du travail tentent par cette marchandise particulière, comme par l’intermédiaire des autres cadences, de garder en permanence sous leur contrôle, leurs esclaves. Ils ne les « invitent » plus dans leurs usines, ou leurs bureaux, comme par le passé, c’est directement dans les banlieues-ateliers où ils sont rassemblés, qu’ils les détruisent à l’aide de leurs nouveaux outils industriels. Les gardiens de la catastrophe font savoir qu’il n’est pas d’endroit où l’on puisse leur échapper Dans le monde converti en usine, la décadence est sonorisée. Le prolétaire des temps cybernétiques, à qui des narco-syndicalistes font croire qu’il ne travaille pas, alors même qu’il ne fait que cela en regardant son salaire disparaître, non content de produire son propre anéantissement dans les dispositifs de la marchandise sous la conduite des psycho-managers, doit également consommer cet anéantissement sous la forme d’effrayants toxiques, tels que néo-musiques, nourritures scientifiquement avariées, maladies, drogues diverses, eau maffieusement pourrie, réseaux de contrôle etc. La marchandise rap fait partie de cette panoplie du rien.(…) Le rap, qui est un vulgaire produit de décomposition, a été élaboré en laboratoire par les services défensifs de la marchandise, et quand il se marie mal avec les banlieues actuelles, comme la liberté avec toi, il est remplacé par des escadrons de CRS, des bataillons de policiers, des voltigeurs associatifs, et d’autres formes d’ameublement urbain, bref, comme en s’en doutait, le rap est un ersatz, un produit de substitution. Il est une police prolongée, son écho en quelque sorte, comme le néo-gauchisme(…) Le rap qui n’est pas une production spontanée de la jeunesse, est un salmigondis de signaux d’identifications issus d’un mélange entre quelques techniques de propagande du primitivisme totalitaire et celles de l’auto-défense marchande. Son aspect de litanie monotone soutenue par des chocs rythmiques répétés a pour but d’entretenir un état utilisable de vacuité spirituelle chez ses auditeurs afin de les diriger vers « les slogans, les formules, les mots déclencheurs » de la protestation falsifiée, et de l’inconscience programmée. Ce concentré de matraque, importé des Etats-Unis par le languisme et ses relais médiatiques associés aux grandes surfaces, se présente aussi comme une possibilité de promotion sociale, c’est-à-dire comme une récompense devant faire accéder un petit nombre de soumis au paradis des images : le rap fait partie des processus de renforcement disciplinaire. Ce qui fascine les putrides policiers du néo-gauchisme dans le rap, c’est que celui-ci leur a permis de revenir sur un terrain qu’ils avaient dû déserter sous leurs vieux costumes. Le respect sournoisement fataliste, que tu montres pour les méthodes autoritaires modernisées, en voulant les faire passer pour un libre choix de la jeunesse qui refuse, alors même que ces méthodes fabriquent des sortes de corps francs informels entièrement acquis aux perspectives totalitaires, voilà qui te range parmi les défenseurs-projecteurs de cette classe invisible, celle qui parle sans cesse au nom de ceux qu’elle tyrannise, sans jamais s’énoncer elle-même en tant que domination, alors qu’elle règne effroyablement […]

